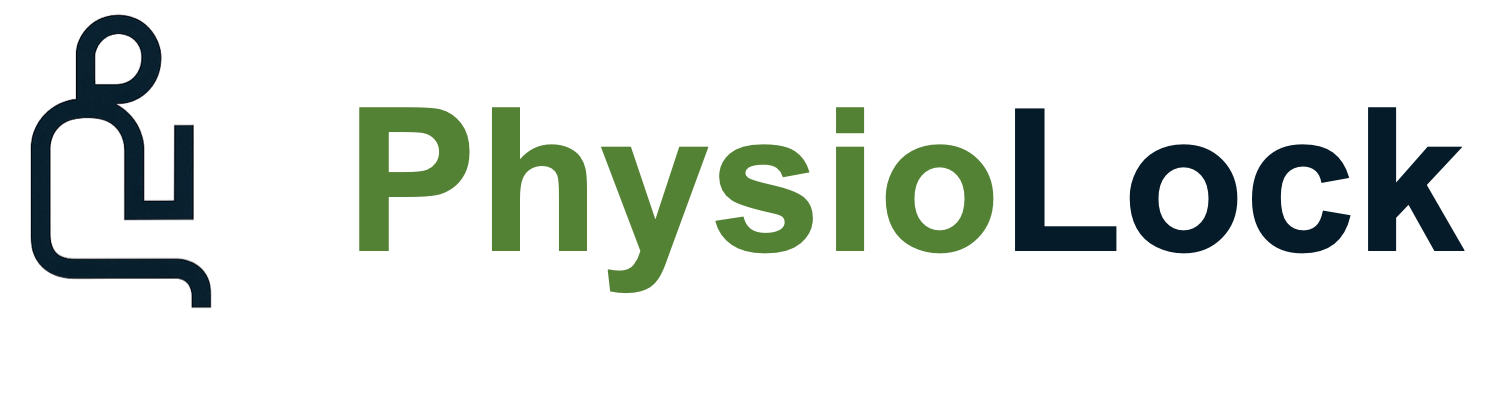Santé au travail et IA : quel horizon pour 2035 ?
Une décennie de ruptures
La décennie 2015-2025 a profondément transformé les entreprises françaises. Accélérée par la digitalisation puis bouleversée par la crise sanitaire de 2020, cette période a vu la généralisation du télétravail et une remise en question fondamentale du rapport au travail.
L’analyse de cette période révèle une déconnexion critique : les indicateurs de performance économique ont divergé de l’état de santé réel du capital humain. Ignorer la santé des collaborateurs n’est plus une option viable ; c’est une erreur stratégique dont l’impact financier est désormais mesurable et significatif.
⚠️ – L’analyse clé pour le décisionnaire
Ce document s’adresse aux comités de direction, DRH et DAF. Il démontre que la santé au travail n’est pas un centre de coût mais un levier de performance. Il fournit une feuille de route pour anticiper les chocs à venir (démographie, IA, réglementation) et bâtir une organisation résiliente à l’horizon 2035.
L’angle mort de la performance : panorama des indicateurs de santé et de productivité (2015-2025)
L’analyse de la dernière décennie met en lumière une divergence préoccupante : alors que les entreprises investissaient massivement dans la technologie, la productivité stagnait et la santé des collaborateurs se dégradait.
1. La productivité française : une croissance ralentie et un décrochage post-crise
Un ralentissement structurel des gains de productivité touche les économies développées, mais la France a connu un décrochage notable depuis 2019.
Le chiffre clé : En 2023, la productivité apparente du travail se situait 5 points en deçà de sa tendance de croissance pré-crise (2011-2019).
Les causes sont multiples (essor de l’apprentissage, politiques de soutien à l’emploi), mais le paradoxe moderne demeure : malgré des investissements technologiques massifs, la productivité stagne. Cela suggère que la capacité humaine à exploiter ces outils est devenue le facteur limitant. Ce décrochage n’est pas qu’une statistique ; c’est le symptôme d’une tension organisationnelle.
2. L’érosion du capital humain : l’explosion de l’absentéisme
Parallèlement, les indicateurs de santé au travail ont viré au rouge, avec une hausse spectaculaire de l’absentéisme.
État des lieux 2023 :
- Taux d’absentéisme national : 6,11%
- Moyenne : 22,3 jours d’absence par salarié sur l’année.
- Près de 37% des salariés ont eu au moins un arrêt.
La mutation clé ne réside pas dans la fréquence, mais dans la durée. La hausse est tirée par les arrêts de longue durée (+90 jours), dont le volume a augmenté de plus de 30% depuis 2019. Ils représentent plus de la moitié du total des jours d’absence.
Les causes profondes de ce glissement, détaillées dans notre guide complet sur l’absentéisme, révèlent la prédominance des risques psychosociaux (RPS). Les arrêts pour motifs psychologiques (burn-out, anxiété) représentent un tiers des arrêts longs et ont augmenté de 40% depuis 2020.
3. Segmentation : les fractures du monde du travail
Les moyennes nationales cachent des réalités très différentes.
- Taille d’entreprise : On assiste à une inversion historique. L’absentéisme a explosé dans les PME et ETI, rejoignant voire dépassant les niveaux des grands groupes. Le pourcentage de salariés arrêtés a bondi de 13 points entre 2021 et 2023 dans les 10-49 salariés.
- Sectorielle : Les secteurs les plus touchés restent ceux combinant pénibilité et charge émotionnelle (Santé/Action Sociale : 8,5% ; Transports : 6,8%). Les services financiers, l’IT ou le conseil sont relativement préservés.
| Indicateur | France 2019 | France 2024 (est.) | Services Fin. 2024 (est.) | Industrie 2024 (est.) | Tech/Conseil 2024 (est.) | TGE (>5000) 2024 (est.) | ETI (250-999) 2024 (est.) |
| Taux absentéisme (%) | 5,5% | 6,0% | 4,5% | 6,8% | 4,2% | 5,5% | 6,2% |
| Part arrêts longs (>30j) (%) | 8% | 10% | 7% | 12% | 6% | 11% | 10% |
| Jours absence / salarié / an | 20,2 | 22,0 | 16,4 | 24,8 | 15,3 | 20,1 | 22,6 |
| Turnover volontaire (%) | 12% | 16% | 14% | 11% | 20% | 13% | 15% |
| Productivité horaire (base 100) | 100 | 98 | 101 | 96 | 103 | 99 | 97 |
Sources : Synthèse Ayming, Malakoff Humanis, WTW, INSEE. Estimations 2024 basées sur tendances 2023-2025.
La facture du désengagement : quantification du coût de la non-santé et du ROI des actions QVT
La dégradation de la santé au travail n’est pas qu’un problème humain. C’est un passif financier majeur, un véritable coût de l’inaction qui grève le bilan.
1. L’iceberg des coûts cachés : chiffrer l’inaction
Le coût de l’inaction est bien plus élevé que celui de la prévention.
- Le coût direct : L’absentéisme coûte en moyenne entre 3 500 € et 4 059 € par an et par salarié. Pour certaines entreprises, cela peut atteindre 10% de la masse salariale.
- Les coûts indirects (l’iceberg immergé) : Souvent non mesurés, ils sont 2 à 3 fois supérieurs et incluent la perte de productivité, la surcharge des présents, les retards, la baisse de qualité et le temps de gestion managériale.
- Le coût du présentéisme : Un salarié présent mais diminué (stress, douleur) coûte environ 2 740 € par an.
2. L’investissement santé : un levier de performance économique
Investir dans la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) génère un retour sur investissement (ROI) élevé et démontrable.
- Le ROI moyen : Les études convergent autour d’un ROI de 2,5 à 4,8 euros pour chaque euro investi(ANACT, PWC).
- Les gains tangibles : Une baisse de l’absentéisme (-25% à -40%), une réduction du turnover (-35%), et une augmentation de la productivité (+20% à +30%).
Le ROI provient des actions structurelles (organisation du travail, formation managériale aux RPS, ergonomie et prévention des TMS) plutôt que des avantages périphériques. Cet investissement en capital humain est un levier direct de performance financière.
Les chocs structurels : mégatendances et nouvelles attentes (2025–2035)
La prochaine décennie sera façonnée par des forces profondes qui redéfiniront la performance et le bien-être au travail.
1. Démographie : le mur du vieillissement et l’impératif de la prévention de l’usure
Le vieillissement de la population active est inéluctable. D’ici 2035, en IDF, la part des actifs de 60 ans et plus doublera. Le nouvel enjeu n’est plus la « gestion des seniors », mais la « durabilité de la carrière ». Il faut s’assurer que les collaborateurs restent en bonne santé et performants sur plus de 40 ans. La prévention de l’usure (physique/TMS, psychologique/RPS) devient une stratégie continue.
2. Organisation du travail : l’hybride et la semaine de 4 jours, entre flexibilité et fragmentation
Les nouveaux modèles sont attendus, mais leur impact dépend de leur mise en œuvre.
- L’hybride : Positif pour la santé mentale pour 66% des bénéficiaires, mais risqué si mal encadré (isolement, hyper-connexion).
- La semaine de 4 jours :
- Avec réduction du temps (32h) : Résultats spectaculaires (absentéisme -65%, burn-out -68%).
- Avec compression (35h sur 4j) : Piège potentiel (journées plus éreintantes pour 43%).
La clé réside dans une refonte des processus, une formation managériale forte et des outils pour maintenir la cohésion.
3. Réglementaire & sociétal : la santé comme actif stratégique (ESG/CSRD)
La réglementation consacre la santé au travail comme un pilier de la performance extra-financière.
La rupture vient de la CSRD, qui impose un reporting de durabilité standardisé et audité. Le pilier « Social » (ESRS S1) exige des indicateurs précis sur les conditions de travail, la santé-sécurité (absentéisme, AT), etc.
La conséquence : la fin du « healthwashing ». La performance sociale devient publique, scrutée par les investisseurs et les talents. Elle rejoint le risque légal SSBE comme un enjeu de gouvernance majeur et impacte directement la marque employeur.
Focus spécial – l’IA comme levier et risque pour la performance humaine
L’Intelligence Artificielle est la rupture technologique majeure à venir, avec un double potentiel.
1. L’IA, amplificateur de productivité et de bien-être
Déployée judicieusement, l’IA peut résoudre des problèmes clés du travail moderne :
- Automatisation intelligente : Libérer jusqu’à 10% du temps des collaborateurs en gérant les tâches répétitives.
- Réduction de la charge mentale : Synthétiser l’information, préparer les décisions et prioriser les tâches pour lutter contre la surcharge cognitive.
- Prévention personnalisée : Identifier les signaux faibles de RPS ou analyser les postures en temps réel pour prévenir les TMS.
2. L’IA, générateur de nouveaux risques psychosociaux
Une implémentation non maîtrisée peut aggraver les RPS :
- Hyper-connexion et intensification : Accélération des flux, pression pour une productivité accrue.
- Déshumanisation et surveillance : Monitoring continu (« scoring »), management algorithmique rigide, érosion de la confiance et de l’autonomie.
- Biais et iniquité : Amplification des discriminations si les algorithmes sont mal entraînés.
La bifurcation stratégique est claire : l’IA sera-t-elle un outil d’augmentation (au service de l’humain) ou de contrôle (extraction d’efficience) ? Ce choix est culturel et managérial.
Conclusion : vers une performance durable ancrée dans la santé
La décennie 2015-2025 a révélé une vérité incontournable : la performance économique ne peut plus être décorrélée de la santé physique et mentale du capital humain. Le coût de l’inaction (absentéisme, désengagement) dépasse largement celui de l’investissement en prévention.
À l’aube de 2035, face aux défis démographiques, réglementaires (CSRD) et technologiques (IA), les entreprises doivent opérer un changement de paradigme :
- Passer d’une gestion réactive des absences à une stratégie proactive de « durabilité des carrières ».
- Considérer la santé et la QVT non comme des coûts, mais comme des investissements à fort ROI, essentiels à la performance durable.
- Déployer l’IA comme un outil d’augmentation, au service de l’humain, en définissant un cadre éthique strict.
La performance de demain se construira sur la capacité des entreprises à intégrer la santé comme un actif stratégique, piloté au plus haut niveau et transparent dans leur reporting.
Sources
Pour la rédaction de cet article, nous nous sommes appuyés sur les publications et données des institutions de référence suivantes :
- INSEE (Blog) – À la recherche des gains de productivité perdus depuis la crise sanitaire
- Malakoff Humanis – Baromètre Absentéisme Malakoff Humanis 2025
- AMF (Autorité des Marchés Financiers) – Le reporting de durabilité CSRD : se préparer aux nouvelles obligations
- ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) – Investir dans le dialogue de proximité et la QVCT, c’est productif